Des Enfers aux Paradis Artificiels
L’Historique d’une Addiction Littéraire
M’hamed BELBOUAB
New York, Londres ou encore
Paris. Un homme voûté au-dessus d’une pile de feuilles éparpillées ou encore d’une
machine clinquante et crépitante. A la lumière de quelques bougies que l’on
devine au travers d’une fumée épaisse, il empile les feuillets comme les
heures, en jette plus qu’il en garde. A ses côtés, une bouteille (du whisky de
préférence) bientôt vide, une pipe, un cigare, ou encore un joint, et puis une
cuillère, parfois même une seringue. C’est un mythe, un cliché qui a la peau
dure, celui d’une alchimie rêvée entre l’écrivain, l’ivresse et la défonce. Vu
parfois comme partie intégrante du processus de création, nous tenterons de
retracer le phénomène à sa source et de saisir l’ampleur depuis bientôt deux
siècles.
Cela devait commencer vers le 19ème
siècle. Plantation du décor : Une France en plein changements sociaux et
politiques, une société prise par le « mal du siècle ». C’est « la maladie abominable
» de Chateaubriand, « la vague des passions », ou encore l’« école du
désenchantement » de Balzac. C’est déjà un peu le spleen de Baudelaire qui
flotte dans l’air, et puis c’est certainement l’ennui chez Flaubert.
Le mécénat n’existe plus, et les
plumes en viennent souvent à vendre leur liberté littéraire, comme Gautier et
Gérard de Nerval qui se sont faits journalistes.
La drogue devient une marchandise
dont la consommation progresse et se banalise. Les plus aisés introduisent les
drogues dans leur milieu social. Se droguer devient une marque de
sophistication, tout comme boire, des breuvages rares et chers néanmoins. La
mode est alors à fumer le haschich « comme un philosophe » et boire « comme un
poète ».
Outre-manche, les « Confessions
d’un mangeur d’opium anglais » de Thomas De Quincey, récit d’un écrivain tombé
dans l’addiction, font grand bruit dès leur parution. Une traduction, «
L’Anglais Mangeur d’Opium » écrite par nul autre qu’Alfred De Musset, ne
tardera pas à paraître.
« Ô juste, subtil et puissant
opium » ! Ces mots qui résument l’ouvrage sonneront un coup de tonnerre dans
l’horizon littéraire au bord de l’orage. Un orage que précipitera un homme, le
docteur Moreau de La Tour. Médecin, spécialiste de l’aliénation, qui, riche de
ses voyages en orient, fonde à l’hôtel de Lauzun, le célèbre Club des
Haschischins. Ceci dans le but de poursuivre ses expérimentations sur les
effets des drogues. Il initie d’abord Théophile Gautier, qui ne tardera pas à
écrire plusieurs textes et comptes rendus de ces séances au club.
Ce dernier y rencontre pour la
première fois, Baudelaire. Le beau monde s’y presse, vous pouviez y croiser
tour à tour les peintres Honoré Daumier et Eugène Delacroix ou encore les
écrivains Gérard de Nerval, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas et Honoré de
Balzac. On y fume alors en groupe et sous le contrôle du docteur Moreau,
pendant des séances aux accents orientaux nommées «Fantasias ».
Gautier se retire rapidement,
conscient de son addiction, tout comme Baudelaire. Pour le premier « le vrai
littérateur n’a besoin que de ses rêves naturels, et il n’aime pas que sa
pensée subisse l’influence d’un agent quelconque ». Quant au second, il dénigre
rapidement les drogues auxquelles il préfère le vin, et puis surtout sa « fée
verte », l’absinthe. Il écrira d’ailleurs : « Le haschisch appartient à la
classe des joies solitaires ; il est fait pour les misérables oisifs. Le vin
est utile, il produit des résultats fructifiant».
Baudelaire ne suivra donc pas
l’itinéraire de son illustre idole, Edgar Alan Poe. « Buveur barbare » des mots
même de Baudelaire, Poe était aussi et sur- tout un grand consommateur de
substances en tout genre. Et c’est d’ailleurs sous leur influence qu’il écrit
probablement le plus célèbre de ses poèmes : Le corbeau.
Sous l’emprise de drogues
récréatives, parfois expérimentales, les écrivains se laissent aller aux nouvelles
sensations : l’infini s’allonge, les bruits ont des couleurs, les couleurs des
sons, les formes changent et les visions se font de plus en plus nettes.
Certains cherchent l’inspiration dans ces vapeurs, tandis que les poètes et
autres maudits y trouveront un énième refuge, avec toujours la même
insatisfaction, le même goût de lendemain de fête.
Le phénomène ne s’estompe guère,
et des exemples plus récents ne manquent pas. Au lendemain des deux guerres,
c’est au tour des surréalistes dans leur quête du « carrefour des enchantements
» de s’adonner aux drogues, même si la position officielle du mouvement en
exclut l’usage.
Les drogues et l’alcool ont
beaucoup d’adeptes dans les cercles de l’écriture. En France, Michaux, poète et
peintre, y consacrera une bonne partie de son œuvre, dans un but purement
expérimental. Il ingérera de la mescaline, la même que consommera Sartre, dans
le but de sonder son inconscient.
Cette substance provoquera chez
lui hallucinations et cauchemars, où lui surgissent notamment des crabes. Il
aura même recours au psychanalyste Lacan pour expliquer puis se débarrasser de
ses visions qu’il aura subies pendant près d’un an.
Mescaline, issue de cactus
américains, passera entre les mains, outre-manche, d’Aldous Huxley. On pourrait
se demander alors si « Le Meilleur Des Mondes », n’est pas celui que connut
fréquemment l’auteur, sous LCD, celui des pérégrinations hallucinatoires et de
l’extase sensationnelle.
Mais s’il existe un endroit où
l’on force la rime entre drogue et littérature c’est bien en Amérique. Symbole
de cette liaison dangereuse, apparait dans les années 1960 la génération
beatnik, formée par des artistes qui se révoltent contre le modèle social américain.
En tête, Kerouac écrivain au talent immense et aux récits de voyages
envoutants, le poète Ginsberg, mais aussi et surtout, Burroughs.
Révoltés par une Amérique
traditionnelle, puritaine et industrielle, nourris par un désir de liberté sans
limite, ils s’acharneront chacun à sa manière à recréer leurs mythes aux
travers de voyages et d’épopées riches en substances illicites. Se lance alors
une véritable contre-culture, aux origines même du mouvement hippie.
L’un d’entre eux notamment,
l’ange noir, William S. Burroughs, est à l’origine d’une des œuvres les plus
marquantes autour de l’écriture et de l’addiction : Le Festin Nu. Véritable
récit alambiqué, écrit sous l’influence de diverses drogues, il révolutionne le
genre et met à nu la réalité dure et crue de la toxicomanie dont souffre
l’auteur. Tour à tour l’addiction y est métamorphosée en singe, un « singe
cramponné au cou », « le singe que les drogués ont l’impression de porter en
permanence sur le dos », c’est « le besoin fait monstre », puis ce sont « Les
jours enfilés à la seringue », tout cela pour aboutir à une véritable « algèbre
du besoin ».
Toute la littérature anglo-saxonne
en regorge : Philip K. Dick, Faulkner, Hemingway, Bukowski, tant de
noms passés à la postérité, ayant
emprunté les chemins suintants de la bouteille et de la seringue. S’en suit une
écriture poignante, au plus proche du réel et du vécu, de plus en cru,
instantanée, des « trips» aux tripes, si caractéristique du 20ème siècle.
On assiste depuis à des
tentatives de plusieurs auteurs, par exemple, Beigbeder, qui, perdus dans une
version ubuesque de la société des loisirs, se parodient, par le vecteur des
drogues, dans une version artificielle de ce qu’aurait pu être une existence
marginale et authentique.
Symbole de rébellion, les drogues
se sont incrustées dans une certaine esthétique de l’art, et de l’artiste en
général, afin de former un mythe tenace ou encore devenir un gage et un
synonyme d’inspiration, de liberté et d’authenticité. Or, le génie de tous ces
auteurs ne saurait se résumer à leur consommation, tout au contraire, très peu
en gardent de bons souvenirs. Le propre de ces esprits, au-delà de leur
fragilité profonde, de leur curiosité débordante, de leur enclin à la
mélancolie, et de leur vécu souvent hors du commun, en font des proies faciles,
que ce soit pour découvrir et sentir le monde autrement, mieux se connaître,
autant que pour mieux oublier, et ne plus rien sentir. Loin d’être une
nécessité artistique, ou le propre des bon écrivains, l’extase de la solution
facile, puis l’addiction, en embuscade, a certainement précipité la mort d’une
grande partie des auteurs cités.
Nécessité ou caprice ? Échappatoire
ou refuge ? La boisson et puis la drogue jalonnent le parcours de la littérature
du 19ème au 21ème siècle. Si l’alcool, lubrifiant social ou étang à chagrins,
semble faire l’unanimité autant dans les milieux artistiques que populaires,
autant pour exalter qu’oublier, il n’en va pas de même pour les drogues. De
l’opium chanté par Quincy, boudé par Baudelaire et Balzac, à la mescaline, et
puis à la coke et au LSD des beatniks, l’artifice fut plus tabou, moins assumé,
et surtout, plus vicieux. Depuis, si certains le revendiquent encore comme
source d’inspiration et outil créatif, il fit les mauvais jours de plus d’un
auteur et précipita la chute de nombreux d’autres. Il n’en demeure pas moins
que cette relation est plus étroite et durable qu’on le pense lorsqu’il s’agit
des artistes, plus enclins à l’aventure et surtout à la dérive.


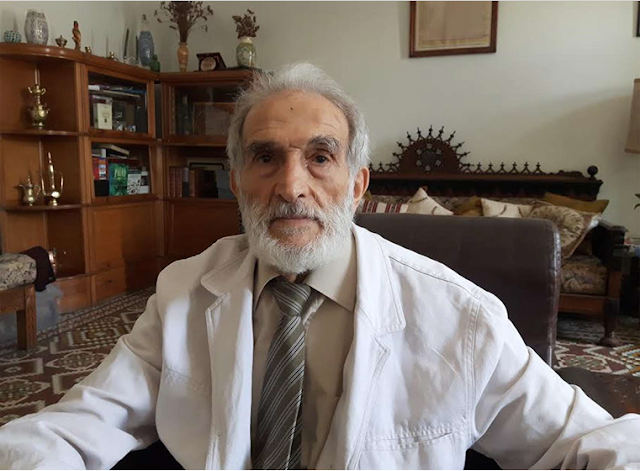
Commentaires
Enregistrer un commentaire