Médecine Algérienne : aux Portes de la Mémoire
Médecine Algérienne : aux Portes de la Mémoire
Thinhinane SARI
Etroitement installé au centre de la capitale, il s’en distingue pourtant de loin.
A peine l’on entre dans son enceinte, l’on quitte le siège du spectateur et l’on prend celui de l’acteur, que l’on est d’ores et déjà, capté par la spécificité de cet endroit. D’un coup, le décor se dénude de ses artifices et s’offre à l’inspection et à la palpation, dévoilant ainsi sa réelle face, longtemps occultée.
Du portail d’entrée à ses différents Services vieux comme le monde, s’entrecroisent de longues allées ombragées du feuillage touffu des grands caoutchoucs. Des passants venus de toutes parts encombrent l’endroit : patients et médecins accourant derrière leurs soucis personnels, oisifs toisant les passants, miséreux demandant l’aumône et couples amoureux se cajolant au coin, ne trouvant abri qu’à l’ombre de la peine humaine. Avec ses pierres et ses hommes, cet endroit édifie à lui seul une ville au centre de la ville. Il est l’hôpital, le refuge et l’asile.
Ses bâtiments, aux mille recoins, sont munis de mille portes.
Ces portes semblent non fonctionnelles à la première attention. Les loquets sont cassés ou détachés, les angles sont embroussaillés de toiles d’araignées et les peintures, grisâtres, sont usées, dénudant les multiples couches sous-jacentes anciennement appliquées aux occasions des visites ministérielles. Pour arriver à un Service, il faut passer par ces portes, et par on ne sait quel miracle, ces portes s’ouvrent et se referment. Et la porte donne sur une autre porte, et de porte en porte se réveille la mémoire…
Médecine antique et romaine
Algérie, dont la terre est vieille de deux millions d’années, est
considérée comme l’un des premiers berceaux de l’humanité. Elle fut témoin des
innombrables fluctuations qu’a subies l’homme, de l’Homo habilis à l’Homo
sapiens, d’un royaume à un autre, d’une civilisation à une autre, mourant et
renaissant de leurs cendres, dressant ainsi une magnifique fresque de la vie
d’un peuple profondément enraciné dans l’Histoire.
D’abord, les Numides. Etant les plus anciens habitants autochtones de
l’actuelle Algérie, ils édifièrent au troisième siècle avant J.-C le royaume de
Numidie. « Grands comme des dieux et forts comme des lions », ils se
distinguaient par leur bonne santé et leur remarquable longévité. N’est-ce pas
Appien, l’historien grec, qui dit d’eux : « Les Numides sont les
plus robustes de tous les peuples africains, et entre tous ces peuples qui
vivent longtemps, ce sont ceux qui ont la plus forte longévité. »
Ceci dit, ils n’avaient pu échapper aux fléaux de l’époque. Le
paludisme avec ses accès palustres sévissait à l’état endémique, la tuberculose
menait inéluctablement vers le décès et, en l’an 125 avant J.-C nous trouvons
une première mention d’une épidémie, probablement la peste. Elle fut
dévastatrice.
Des établissements de santé étaient édifiés et réservés totalement ou
partiellement aux malades, où ils pouvaient loger, manger et recevoir des soins
médicaux gratuitement, le médecin étant exonéré en contrepartie des charges
publiques et bénéficiant de la position d’archiatre (médecin officiel de la
famille royale). Quant aux patients ne pouvant pas se déplacer, les médecins
accouraient les soigner à leur chevet, ce qui nous renseigne déjà sur les
fondements de la relation médecin-malade, tel que rapportée par Apulée de
Madaure dans son œuvre « Florides » : « Dès que le
médecin s’est assis à côté du malade, il lui prend la main, il la palpe
longuement et en tous sens, il s’efforce de saisir les battements du pouls et
mesurer leurs intervalles. » Cette médecine, profondément inspirée de
l’école hellénique, était essentiellement naturaliste.
A partir du IVème siècle jusqu’au Vème siècle,
un enseignement médical était assuré à Hippone. La formation s’étendait sur 5
ans et contenait un volet théorique et un volet pratique au lit du malade.
De nombreux médecins ont marqué cette période : Aumastin
Imaillin, Maximus, Cassius Félix l’auteur de « Medicina », Juba II
qui était aussi médecin naturaliste, et le célèbre Apulée de Madaure, natif de
l’an 125, auteur de la grande œuvre « l’Ane d’or », roman imaginatif écrit
à la première personne, où l’auteur, de son vrai nom Lucius Apuleius, raconte
les péripéties de Lucius, personnage qui avait des traits d’âne mais un cœur et
un esprit humains.
Médecine musulmane en Algérie
D’une porte à une autre, des salles, puis des corridors, puis encore des corridors et des salles se multiplient invraisemblablement. Eclairés par des lampes d’une lumière pâle, troublante, ils laissent défiler sous nos yeux les patients, mus dans leur foulée par leurs peines ; les moins souffrants cherchant les mots pour crier leurs maux, les plus souffrants, invoquant de la sollicitude, font de leur silence une prière. Et puis les médecins, essayant tant bien que mal de se contenir, laissent échapper dans un soupir, une prière.
Car la peine humaine, impuissante comme elle est, ne trouve de consolation que dans le mystique.
Des offrandes aux pieds des autels, aux pleurs aux sépultures des Saints, le recours au mystique dans un espoir de guérison alourdit l’histoire des hommes. A titre d’exemple, un ensemble d’édifices religieux du nom d’Asclepieum a été retrouvé à Lambèse (Tazoult, wilaya de Batna), consacré à Esculape, dieu grec de la médecine et de la bonne santé. Avec sa fille Hygie, ils étaient adorés par les romanisés dans les cités berbéro-puniques, sur l’étendue de l’empire romain.
De même la médecine, fruit d’une réflexion philosophique et d’un travail scientifique, fut depuis toujours étroitement liée au mysticisme. Apulée lui-même rapporte le recours des médecins aux incantations dans la pratique de leurs soins, et « qu’Ulysse connaissait les formules au moyen desquelles on arrête le sang qui s’échappe des blessures ».
Avec l’avènement de l’Islam en Afrique du nord au VIIème siècle, le spiritualisme musulman prit le relais et s’ancra dans les croyances populaires. Les médecins s’inspirèrent alors du Coran et de la sunah pour établir une médecine naturaliste essentiellement basée sur l’hygiène de vie individuelle et communautaire et les mesures de prophylaxie.
La succession de nombreuses souverainetés sur le territoire algérien ainsi que la position géographique charnière qu’occupe ce dernier, relais entre l’Orient et l’Andalousie et refuge des Andalous et des juifs, ont permis un essor remarquable en sciences médicales. Des Aghlabides aux Hammadites, passant par l’époque des Almohades, des Fatimides et des Zianides, de grandes villes telles que Bejaia et Tlemcen ont vu le jour, et sont devenues même, entre le VIIIème et le XVème siècles, de véritables minarets civilisationnels.
Dans la même optique, l’héritage scientifique et philosophique grec fut traduit, assimilé et adapté par la pensée arabe. Nous retrouvons à titre d’exemple la théorie des quatre humeurs qui fut introduite à la pensée arabe par les écoles d’Andalousie et du Moyen-Orient, modifiée par Ibn Sina et Ibn Rochd.
L’enseignement médical, délivré au sein des médersas (qui faisaient office d’Universités) qui étaient financées par les habous (waqf), se référençait aux œuvres de grands auteurs musulmans, tels que le Poème de Médecine d’Ibn Sina, El Harounya de Ed Dimachki, El Koulliyyat fi Tibb d’Ibn Rochd et même Hayy Ibn Yaqdhan de Ibn Tofail.
Hassan al-Wazzan (Léon l’Africain), le diplomate et explorateur d’Afrique du Nord du XVème au XVIème siècle, décrivit dans ses œuvres de nombreux hôpitaux, notamment celui de Tlemcen bâti par Youcef Ibn Yacoub, et celui de Bejaïa, qui étaient des centres hospitaliers d’envergure avec un personnel qualifié de médecins naturalistes, d’infirmiers et de pharmaciens. Il décrivit aussi de nombreuses maladies régnant à son époque sur le territoire de l’actuelle Algérie, telles que l’épilepsie, l’éléphantiasis et les fièvres endémiques. La syphilis, quant à elle, a été décrite à Tlemcen, au XVème siècle, ramenée par les juifs qui fuyaient l’Andalousie après la chute de Grenade. Ibn Khaldoun à son tour rapporte la notion de peste à plusieurs reprises, mais évoque également la récurrence des maladies des riches, telles que la goutte, dont ont été victimes plusieurs sultans.
Médecine à l’époque ottomane
Interpellant médecins et infirmiers dans un des couloirs, un parent d’un patient, terriblement coléreux, riposte contre leur grande attente au pavillon des urgences.
« Ça fait deux heures que j’attends qu’on prenne en charge mon parent. Ce n’est pas possible. Je n’habite qu’à proximité, je suis prioritaire. »
« Où résidez-vous, Monsieur ? »
« Badjarrah. »
Badjarrah, variante de Bachdjerrah, veut dire chirurgien-chef. A l’époque ottomane, la médecine pouvait être répartie en trois. D’abord la médecine militaire, sous la responsabilité du chirurgien-chef, encore appelé amin des médecins, destinée aux janissaires, aux soldats et aux navires militaires ; la médecine populaire essentiellement naturaliste, continuité de la médecine musulmane, où le médecin est appelé hakim, qui s’exerçait dans les zaouïas principalement ; et enfin la médecine européenne destinée aux détenus, dans les hôpitaux érigés dans leurs bagnes.
La santé publique était maintenue par les règles d’hygiène publique facilitée par l’installation des fontaines publiques, des thermes et des réseaux d’assainissement. Toutefois, l’état de guerre permanent à cette époque a détérioré l’état de santé des habitants et handicapé l’épanouissement de la vie intellectuelle et scientifique. Ceci dit, « Sous les Ottomans, même si la caste militaire turque misait d’abord sur la suprématie militaire au détriment de l’épanouissement culturel, l’état intellectuel et moral était toujours représenté par les institutions religieuses : mosquée, zaouïas, medersa, etc. » Auguste Cour.
En effet, les zaouïas, institutions de bienfaisance mais également de formation et de soin, étaient des hôtels pour les voyageurs, des refuges pour les démunis mais aussi des établissements sanitaires pour les souffrants. Elles représentaient aussi des centres d’enseignements des sciences, des lettres, de la religion et de la médecine, où les ouvrages d’Ibn Sina, d’Ibn Rochd et d’Ibn El Baitar, étaient enseignés. Les zaouïas ont joué un rôle considérable dans le drainage culturel et moral de la société.
Quelques hôpitaux commençaient à être édifiés par les Ottomans en Algérie, tels que l’hôpital Kharratine bâti en 1550 à la rue Beb Azzoun, destiné aux militaires, ou l’hôpital du Fort des Vingt-Quatre Heures érigé à Beb El Oued. On retrouve aussi les hôpitaux destinés aux chrétiens et aux détenus, et du fait de l’exercice libre de la médecine, de nombreux médecins européens venaient exercer en Algérie.
Parmi les médecins naturalistes éminents de l’époque, le célèbre savant algérois Abderezek Ibn Hamadouche El Djazairi né en l’an 1695, qui fut sans conteste le plus grand médecin algérien de l’époque. Il était qualifié de médecin, pharmacien et herboriste. Il a laissé dix-huit ouvrages, dont son célèbre livre très en vogue à l’époque « Révélation des énigmes dans l’exposition des drogues et des plantes - Kechf Erroumouz » qui est un véritable travail de recherche scientifique, où il confirme l’étendue de sa grande connaissance, loin des spéculations et des superstitions, et fut ainsi qualifié « d’homme à la pensée originale et à l’optique moderne et rationaliste ».
La médecine algérienne au temps de la colonisation
A l’hôpital Mustapha, les fenêtres sont hautes de dix pieds, larges d’une demi-toise, incrustées dans des murs qui s’élancent loin vers le plafond.
Ce style architectural, typiquement français, renvoie à l’histoire de la construction de l’hôpital.
Bâti sur les terrains des descendants du Dey Mustapha qui gouverna Alger de 1798 à 1805, avec comme financement le legs d’un riche colon du nom de Fortin d’Ivry, il ne fut inauguré qu’au 1er août 1854, soit 24 ans après le début de la colonisation française du territoire algérien, en 1830. Une colonisation qui dura 130 ans.
130 ans durant lesquels la santé algérienne a connu deux grandes étapes.
D’abord, au XIXème siècle, « Guérir pour Conquérir ! » ; la médecine fut instrumentalisée pour des fins politiques de conquête et d’infiltration. Avec l’avènement du XXème siècle et la prolifération des mouvements de résistance nationale, vint la deuxième étape ; la médecine devint alors un outil de marginalisation de la population autochtone.
Mirabile dictu, contrairement aux idées reçues, à l’arrivée de la colonisation française, la plupart des algériens savaient lire et écrire.
L’enseignement primaire était généralisé, et dispensé au niveau des écoles primaires, Alger en comptait une centaine. L’enseignement secondaire était délivré dans les grandes villes dans les établissements secondaires, et Alger en comptait une douzaine. Enfin, l’enseignement supérieur médical était dispensé au niveau des grandes mosquées et des zaouïas, fiancées par les habous et la zakat, les biens et les offrandes de la population, ces zaouïas qui servaient aussi bien d’auberges, d’hospices et de centres de soin. Cependant, avec la politique de dépossession suivie par la France en 1843, les biens habous ont été inclus dans les domaines publics, privant ainsi les zaouïas du financement.
La médecine était alors une médecine traditionnelle naturaliste, fruit d’un héritage populaire profondément enraciné dans les mémoires. Le médecin traditionnel, encore appelé hakim exerçait librement. Toutefois, avec la colonisation, une permission du « bureau arabe » s’imposa. Ensuite, une formation de deux ans à l’école de médecine devint nécessaire pour l’exercice des fonctions.
L’Emir Abd El Kader portait une grande ambition pour l’enseignement médical, par son projet de fondation d’une école de médecine, qui malheureusement, n’est pas arrivé à terme. Il désigna son médecin Abdallah Ezzarouali comme responsable du système de santé algérien. Sous la tutelle de l’Emir, un hôpital, bimaristan, était bâti dans chacune des huit grandes circonscriptions et les soins y étaient dispensés pour les civils et les militaires.
En 1855, des cours de médecine commençaient à être dispensés à l’hôpital du Dey à Bab El Oued, ainsi qu’à l’hôpital Mustapha, à l’adresse d’une dizaine d’élèves musulmans, et ce n’est qu’en 1858 que l’Ecole Préparatoire de Médecine et de Pharmacie fut créée. Héritière de l’école d’instruction de l’armée qu’organisa Baudens en 1832 à l’hôpital du Dey, elle ne devint fonctionnelle qu’en 1859 et eut comme directeur le Docteur Bertherand. Cependant, elle ne délivrait en médecine que des diplômes « d’Officiers de Santé » après trois ans de théorie ou cinq ans de pratique. Pour octroyer le titre de « Docteur en Médecine », une formation de deux ans dans la métropole était imposée.
En 1880, l’Ecole Supérieure de Médecine et de Pharmacie fut créée, avec ses quatre chaires : physique, matière médicale, anatomie pathologique et histologie et maladies des pays chauds. Cependant, cette école supérieure ne délivrait toujours pas de diplôme de doctorat, et ce n’est qu’avec la loi de 1909, avec la création de la Faculté de Médecine et de Pharmacie à la même année, que la faculté de médecine d’Alger eut son autonomie de celle de Montpellier dans la délivrance des diplômes. Cette faculté avait comme premier doyen le Docteur Curtillet. Elle comportait seize chaires, et son développement fut rapide, marqué par le passage du chirurgien Eugène Vincent qui est considéré comme le véritable père de l’école chirurgicale d’Alger, ainsi que le Professeur anatomiste, Jean Baptiste Paulin Trolard, dont une des veines anastomotiques du cerveau porte le nom. Toutefois, il est à noter que le nombre d’étudiants algériens inscrits à la faculté de médecine d’Alger reste très restreint (1919 – 1920 : 15 musulmans pour 344 européens), contrastant avec la mission « civilisatrice » dont se vantait la colonisation.
L’Institut Pasteur à son tour, créé le 1er novembre 1894, fut fut consacré à la préparation des vaccins pour les troupes militaires des forces coloniales lors de la première et la deuxième guerre mondiales.
La santé des algériens se dégradait de plus en plus, la mortalité était très élevée suite aux affrontements militaires et à la détérioration de la qualité de vie ; les épidémies, comme celle du choléra en 1825, ont été dévastatrices.
Suivant la politique de « Guérir pour Conquérir ! », les forces coloniales ont établi diverses stratégies visant à extirper le musulman de ses racines. Les hôpitaux militaires furent établis au sein des mosquées, transgressant le culte du sacré et levant le voile sur l’intimité des gens. Aussi, des programmes de santé généralisés ont été appliqués, comme celui de la vaccination antivariolique qui a pris un caractère obligatoire afin de soumettre la population à la « lumière civilisatrice », fortement réprouvée par la population autochtone. Des enquêtes médicales épidémiologiques et démographiques ont été lancées, et qui ont servi le but principal de la procédure : celui de la collecte de renseignements.
Ceci n’a pas empêché les musulmans d’éclore dans le domaine médical. Cependant, la position du premier docteur en médecine algérien est différée selon les auteurs, divisés entre le Dr. Mohammed Nakkach et le Dr. Benlarbey Mohamed Séghir. Des médecins algériens de cette époque nous citons le Dr. Mostapha Hadj Moussa, qui a joué un grand rôle dans l’éveil du mouvement nationaliste, le Dr. Taieb Morsly qui a brillé avec ses nombreuses publications.
O altitudo ! Vers quelles profondeurs mènent donc ces escaliers ?
S’enfonçant tel un serpent dans les murs de l’hôpital, des escaliers à la pente abrupte frayent le passage vers le Service.
L’embouchure est à peine visible du haut du premier giron, le chemin parait rude, rêche, revêche, et à peine que l’on descend les premières marches que la lumière se raréfie et l’escarpement se raidit, à faire perdre l’aplomb.
Que faire ? Faudrait-il abdiquer ? Comment parvenir au Service alors ? Dans la descente, les escaliers s’allongent démesurément, l’air se condense et les pupilles, dans le noir, s’écarquillent en mydriase.
Mais la mydriase, phénomène d’adaptation, optimise la vision dans le noir, et de marche en marche, voilà que le chemin sinueux prend de la rectitude. Le regard est dès lors fixé sur l’embouchure, le pas s’accélère, et ni l’absence d’air ni celle de la lumière ne semblent freiner la foulée.
Encore une dernière marche, et voilà la dernière porte.
Avec l’avènement du XXème siècle, l’état de santé des algériens se dégrada de plus en plus. De grandes épidémies telles que le typhus, le paludisme et la tuberculose faisaient ravage, la mortalité des enfants atteignit son apogée. Les guerres successives (mondiales I et II et la guerre de l’indépendance) ont dégradé l’état de santé algérienne, tel qu’en témoigne la conscription, à travers les rapports médicaux établis lors des visites médicales : « C’est un véritable musée de pathologie que l’on voit défiler pendant presque deux mois et certains individus sont dans un état de déchéance à peine croyable. »
Le système de santé était principalement réparti sur trois catégories :
D’abord, la santé coloniale dans les hôpitaux civils destinés aux colons. Ensuite, la santé militaire qui ne cessait de se renforcer et restait dominante par ses infrastructures et son personnel. Et enfin la santé des Algériens, qui se résumait à une simple « Assistance médicale aux indigènes ». A partir de 1904, des « infirmeries indigènes » virent le jour, avec une logistique très modeste et ne répondant guère aux besoins de la population.
La faculté connût de grands noms, tels que Costantini, Emile Leblanc et René Marcel De Ribet. Des algériens, nous citons Aljia Inoureddine, première étudiante musulmane aux rangs de la faculté qui sera la première femme Professeur en pédiatrie après l’indépendance.
Avec le déclenchement de la guerre de libération nationale en 1954, les quelques étudiants inscrits à l’université commencèrent à quitter les rangs pour rejoindre le maquis et l’ALN, et occupèrent des postes importants, tel que Atsamena qui devint médecin Chef de la wilaya I, Lamine Khène qui fut Chef du Service de la santé de la wilaya II et Youcef Khatib, membre du Conseil de la wilaya IV. Citons aussi le grand Frantz Fanon, psychiatre à l’hôpital de Blida, qui rejoint les rangs du FLN (Front de Libération Nationale) en 1954. Il décortiqua de très près le complexe de dépendance du colonisé et analysa le processus de décolonisation. Il était fortement investi dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie.
Avec l’appel à la grève lancé aux étudiants algériens par l’UGEMA (l’Union Générale des Etudiants Musulmans Algériens) en septembre 1957, une véritable chute des étudiants inscrits à la faculté de médecine fut signalée. Néanmoins, le service de santé était parmi les grandes préoccupations de l’FLN, le GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) créa le Ministère de la Santé et des Affaires sociales, mais l’implantation des services de santé demeura fragile. Ceci dit, la guerre prenait de plus en plus d’envergure et les forces coloniales, se heurtant à la réalité de la présence d’un nationalisme algérien aussi solide que résistant et ayant épuisé tous leurs moyens, eurent recours à la politique de « la terre brûlée » afin de soumettre à l’agonie la population et de ne rien laisser derrière eux. Ainsi, la bibliothèque universitaire fut incendiée par l’OAS en juin 1962, emportant dans sa fumée une bibliographie aussi riche que diversifiée, héritière de la bibliothèque de l’hôpital du Dey.
De porte en porte se réveille la mémoire, de porte en porte les murs se diaphanéisent et le spectacle est déjà offert. Sur un des murs, 59 portraits de médecins, hommes et femmes, sont dressés en face de la porte d’un amphi, une porte qui porte comme écriteau des paroles de Montesquieu ainsi marquées : « Il faut avoir beaucoup étudié pour savoir peu ». Aldjia Inoureddine, Nefissa Hammoud, Mohamed Nekkache, Mohamed Lamine Debaghine, Benyoucef Benkhedda (pharmacien), Mohamed Toumi, Frantz Fanon, Pirre Chaulet, Michel Martini et bien d’autres encore ; ces médecins algériens de naissance ou d’adoption se sont approprié la cause, ont préservé l’héritage et œuvré pour un avenir meilleur. Rires et pleurs, soupirs et clameurs de longues années de labeur se confondent à l’écoute, pour écrire avec des notes aiguës et graves la partition d’une magnifique symphonie. L’Algérie.
Une dernière porte, située au dernier recoin, et déjà la grande salle de colloques du Service. Huit heures trente minutes, toute l’équipe est déjà là. Le rapport de garde peut commencer.
« Il s’agit du patient Monsieur B.M, âgé de… »
Références
- Livre « Histoire de la
médecine en Algérie, de l’antiquité à nos jours » du Docteur Monsieur
Mostefa Khiati.
- « Santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé en Algérie », site sous la responsabilité éditoriale du Professeur Larbi ABID : http://www.santetropicale.com/santemag/algerie/presentation.htm.
- « CDHA – Centre de documentation historique sur l’Algérie » : http://www.cdha.fr/lhopital-de-mustapha.
- Livre « Algérie des origines, de la préhistoire à l’avènement de l’histoire » de Gilbert Meynier.
- Site officiel du CHU Mustapha Pacha : https://www.chu-mustapha.dz/c-h-u/histoire-du-chu/.
- http://www.academia.edu/12646121/M%C3%A9decine_Botanique_et_Pharmacop%C3%A9e_au_Maghreb.
- http://www.babzman.com/guerre-de-liberation-organisation-du-systeme-de-sante/
- Wikipédia.
- Livre « Algérie des origines, de la préhistoire à l’avènement de l’histoire » de Gilbert Meynier.
- Site officiel du CHU Mustapha Pacha : https://www.chu-mustapha.dz/c-h-u/histoire-du-chu/.
- http://www.academia.edu/12646121/M%C3%A9decine_Botanique_et_Pharmacop%C3%A9e_au_Maghreb.
- http://www.babzman.com/guerre-de-liberation-organisation-du-systeme-de-sante/
- Wikipédia.



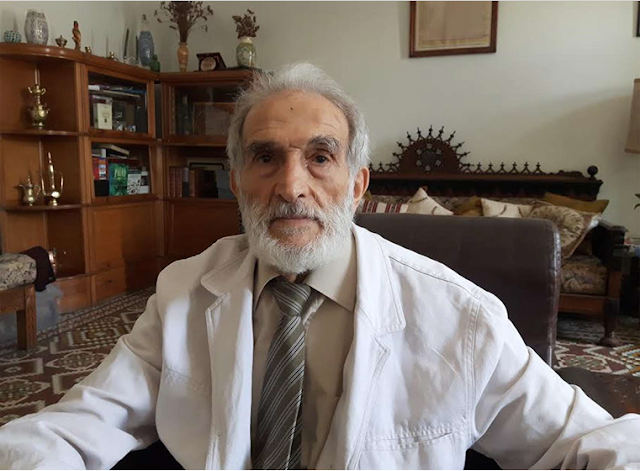
Commentaires
Enregistrer un commentaire