Un voyage à travers la folie
Un Voyage à travers la Folie
Halima DEKKICHE
L’homme, sans que l’on ne sache ni pourquoi ni comment, peut perdre ce précieux caractère qui le différencie des autres créatures : la raison. Cependant, la raison s’est toujours retrouvée perplexe face à « la perte de la raison », et a souvent eu du mal à l’expliquer et à la guérir. Des grimoires de sorcellerie passant par les livres Saints jusqu’au DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), de la possession démoniaque à la maladie mentale ; l’histoire de la psychiatrie porte les empreintes de plusieurs médecins, philosophes, hommes de religion, et même de sorciers et charlatans, qui ont contribué à l’apparition et au développement de ce monde où la folie et la raison se confondent et dont l’énigme n’est pas encore résolue.
Le voyage au cœur de la folie commence à l’antiquité. Nous voilà dans une grande cérémonie où les gens, villageois ou citadains, se prêtent à des rites de sorcellerie : « on doit chasser le diable ! ». Fouettés et même brulés vifs, les fous de étaient accusés de réincarnation diabolique et démoniaque.
Ces croyances étant bien ancrées dans l’esprit des gens, la médecine ne pouvait que s’y soumettre et prêter ses vertus à ces « purifications ». Preuve en est la découverte sur de très anciens cadavres de traces de trépanation dont le but était de libérer le malade du démon qui l’habitait.
Néanmoins, certains philosophes osèrent braver les dogmes et réfléchir sérieusement à la question de la folie. Ainsi, la vision envers les fous commença à changer, et pour la première fois la folie fut considérée comme une maladie. Hippocrate, le père de la médecine, dans son corpus hippocratique, a établi la première nosographie dans l’histoire de la médecine, qui consiste en une description et une classification méthodique des maladies, parmi lesquelles les quatre maladies en relation avec l’actuelle psychiatrie : l’Hystérie, la Manie, Phrenitis (délire) et la Mélancolie, en plus de l’Epilepsie.
Le déclin de l’empire romain : moyen âge ou âge d’or ?
Après la chute de l’empire romain, l’occident sombrât dans le noir et l’ignorance. La dominance autocrate de l’église et le christianisme extrémiste a fait reculer l’occident aux siècles passés de la première antiquité et ses pratiques barbares. Il existait des tribunaux pour les sorciers, qui sont des êtres humains ou inhumains qui font un pacte avec le diable et dont les victimes sont appelées des possédés.
Cependant, de l’autre côté du monde, ce fut l’âge d’or de la civilisation arabo-musulmane, avec leur savoir et leurs sciences. Le premier asile pour malades mentaux fut bâti à Baghdâd en 705, ainsi que d’autres asiles dans différents coins des contrées musulmanes, notamment à Fès, Damas, et le Caire. Ces asiles prodiguaient l’hygiène, la nourriture et les soins, et même des psychothérapies, telles que citées par Ibn Sina dans son Canon au Xème siècle. Il écrivit : « Nous devons considérer que l’un des meilleurs traitements, l’un des plus efficaces, consiste à accroitre le mental et psychique du patient, à l’encourager à la lutte, à créer autour de lui une ambiance agréable, à lui faire écouter de la bonne musique, à le mettre en contact avec les personnes qu'il agréé, qui le respectent et en qui il a confiance. » On reconnaissait donc l’importance de la bientraitance des fous et, comme thérapie révolutionnaire, on avait même adopté la musicothérapie. En effet, la musique se jouait dans ces asiles, appliquée selon la réactivité du malade pour telle ou telle musique, selon un rythme et une mélodie précise. Dans ses soins, on raconte qu’Ibn Sina avait même essayé le traitement de choc, en déchirant le voile couvrant le visage d’une femme qui avait les mains paralysées. Effrayée, elle bougea ses bras pour se protéger.
Cependant, vers la fin du moyen âge, la conscience occidentale commença à se réveiller. Le premier asile psychiatrique « Bethlem Royal Hospital » fut construit à Londres, mais la thérapeutique ne se basait que sur la réclusion et la coercition.
La renaissance, l’occident voit le jour
L’occident connut alors un air de révolution, orchestré par plusieurs savants, notamment Erasme, le prince de l’humanisme, connu pour ses idées anticonformistes, qui appelait à la reprise des idées païennes de l’antiquité et à se libérer de l’église. Son œuvre « l’éloge de la folie » ainsi que celle de l’humaniste Thomas More « utopie », ont fait vibrer toute l’Europe, et ont participé à la révolution de la renaissance qui a ouvert les portes aux philosophes pour s’exprimer dans tous les domaines.
Cette époque a affiné la naissance de la psychiatrie. D’un côté, la naissance de la philosophie moderne initiée par René Descartes, qui avait repris les idées sur l’âme et le corps et conçut le dualisme cartésien, provoquant ainsi le débat sur la séparation et la causalité entre l’âme et le corps. D’un autre côté, le développement de la médecine, marqué par la naissance de la neurologie au XVIème siècle et la découverte de la cause de plusieurs maladies neurologiques habillées de signes cliniques psychiques, mais aussi par plusieurs œuvres traitant indirectement de la psychiatrie, notamment « l’anatomie de la mélancolie » de Robert Burton où il avait décrit les causes, les symptômes et le traitement de la mélancolie.
Au sein du mouvement philanthropique, le médecin Joseph Daquin entreprit le début de l’aventure au cœur de la déraison et la folie, en publiant son livre « la philosophie de la folie » en 1791, faisant de lui le premier à créer la médecine aliéniste, qui deviendra plus tard « la psychiatrie ».
Cependant, la psychiatrie fut principalement influencée par Philippe Pinel. Il travaillait à Bicêtre dans un hôpital qui recevait les aliénés dans leur état pitoyable et miséreux, enchainés et renfermés. Jean Batiste Pussin, un surveillant à l’hôpital, avait beaucoup d’empathie pour ces malades, il vouait son temps à prendre soin d’eux tant sur le plan moral que physique, et il notait les changements qu’ils réalisaient. Pinel, s’appuyant sur les notes du surveillant, a commencé à parler du traitement moral, à supprimer les chaines, la phlébotomie et tout autre traitement inhumain et inutile. Il pensait que la maladie mentale est une atteinte physiologique, provoquée par des émotions et des événements du passé de l’être. En croyant qu’il y a une part de raison chez les aliénés, il essayait de discuter avec ses malades afin de stimuler cette partie de conscience chez eux. Quoique les résultats ne fussent pas très satisfaisants, ceci l’a aidé à créer la première nosographie philosophique des maladies psychiatriques dans son œuvre « Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale », distinguant ainsi quatre cas : la manie, la simple mélancolie, l’idiotie et la démence.
Période organiciste de la psychiatrie
La découverte de plusieurs maladies à étiologie organique ayant une expression psychique prépondérante (Alzheimer, crétinisme, certaines tumeurs cérébrales, la paralysie générale…), a été à l’origine d’une approche organiciste exclusive, mais qui a été vite abandonnée plus tard pour d’autres axes de recherches.
En effet, au XIXème siècle apparut le père de la neurologie moderne : le neurologue Jean Martin Charcot, qui donna son nom à la sclérose latérale amyotrophique SLA (la maladie de Charcot). Dès 1870, il s’est consacré à la psychiatrie en essayant de trouver des causes pathologiques organicistes aux différentes expressions psychiques.
A cette époque, au sens de la société occidentale, la femme était marginalisée, réprimée et sans possibilité d’expression ni au sein de la famille ni dans l’espace public, la poussant à privilégier le langage du corps dans toutes les attitudes corporelles (mouvements de torsion, attitudes clownesques…). La majorité des malades mentaux des hôpitaux psychiatriques étaient des femmes, en majorité des hystériques, sur lesquelles Charcot a réalisé des travaux approfondis en tentant une approche anatomoclinique. Malgré ses vaines tentatives, l’expression de « la grande crise de Charcot » fut employée pour décrire les grandes attaques hystériques et ses expériences ont inspiré les jeunes générations de psychiatres en contribuant à mettre une frontière entre la neurologie et la psychiatrie.
Parmi les contributions majeures de Charcot, il est utile de citer les multiples contradictions anatomo-clonique auxquelles il fit face. Il se rendit compte que beaucoup de ses patients souffraient de symptomatologie réelle mais sans aucun substratum anatomique. Par exemple, beaucoup se plaignaient de paralysie ou de mouvements anormaux des membres ; il était aisé de déterminer l’origine anorganique de ces troubles puisqu’ils ne correspondaient absolument pas à la réalité anatomique, à l’image de ce patient qui avait le bras paralysé bien ques ses doigts pouvaient bouger normalement…
C’est ainsi que Charcot a pu déterminer que l’hystérie était une conversion de la psyché vers l’organique. En d’autres termes, lorsque la verbalisation ne fonctionne pas, c’est à travers le corps (le soma) que se manifeste le conflit psychique.
Enfin, notons que c’est également à lui que revient le mérite d’avoir infirmé définitivement le postulat que l’hystérie était une maladie exclusivement féminine (rappelons que l’étymologie du mot renvoit à hystericus, relatif à l’utérus).
A la même époque, en Allemagne, le psychiatre Emil Kraepelin, fondateur de la psychiatrie scientifique moderne, suivait ses malades durant des années et observait l’évolution des symptômes et leurs différentes formes. En travaillant sur la nosographie, il ajouta deux maladies psychiatriques : la psychose maniacodépressive (actuellement nommée trouble bipolaire) et la démence précoce (devenue schizophrénie après les travaux de Bleuler).
Notant aussi les travaux du psychiatre français Gatian De Clerembault sur les psychoses délirantes, et sa description détaillée de l’érotomanie (le délire d’être aimé) qu’on appelle aussi le délire érotomaniaque de De Clérambault.
La psychanalyse
Les idées qui nous viennent à l’esprit, qui façonnent nos rêves et nos les phobies et qui déterminent nos actes, ne sont pas le fruit du hasard ; l’homme a dû vivre dans son passé des épreuves dont il est « inconscient », et garde des traumatismes qui se manifestent par des symptômes psychiques à forte répercussion sociale. C’est la psychanalyse, créée par le neurologue Sigmund Freud, qui fut principalement influencé et inspiré de la méthode cathartique qu’exerçait le médecin autrichien Josef Breuer sur sa patiente hystérique « Anna O ». Il la détailla en 1905 dans son premier topique de conscient/inconscient, et y ajouta après quelques années la théorie des pulsions, créant ainsi son deuxième topique ça/moi/surmoi, instances qui constituent la personnalité de l’homme. Le « Ça » qui constitue le plaisir ou la pulsion à assouvir là et maintenant, le « Moi » étant la partie du « ça » la plus consciente et qui s’exprime dans la réalité, et enfin le « Surmoi » qui gère l’équilibre entre ces deux instances, qui représente la voix qui refuse et accepte l’expression du « ça » dans la réalité. Ici, l’inconscient remet en cause le libre-arbitre et les actions conscientes car les raisons de nos actions ne sont plus transparentes. L’inconscient remet aussi en cause la raison qui implique une conscience totale ; la raison c’est oublier les leçons de la psychanalyse et que l’homme est un produit social.
La cure psychanalytique est une approche thérapeutique qui permet au thérapeute d’analyser le matériel psychique en essayant de l’intégrer aux mécanismes inconscients et de donner un sens aux non-dits par l’établissement d’un équilibre entre ces 3 instances qui constituent la personnalité.
D’autres courants psychanalytiques sont apparus après Freud, gardant toujours les mêmes principes Freudiens, dont les plus célèbres sont Jacques Lacan et de Carl Gustave Jung. La majorité des maladies mentales furent définies et décrites cliniquement, mais les psychanalystes n’arrivaient pas à traiter par des protocoles consensuels. De plus, la psychanalyse ne concernait que le milieu mondain, du fait du taux élevé des honoraires conséquentes et des durés prolongées des cures qui avaient, toutefois, des résultats souvent mitigés. Ceci étant, en soignant les bourgeois dans son cabinet, Freud découvre des principes universels qui concernent les pauvres et les riches.
L’évolution des thérapies
Les thérapies de choc constituaient les seuls outils thérapeutiques dont disposaient les psychiatres du milieu du 19ème. En effet, Lapipe et Rondepière affinèrent la sismothérapie (électrochoc) qui consiste à créer une crise d’épilepsie par le passage d’un courant électrique trans-crânien, partant du faux postulat que la comorbidité psychose et épilepsie n’était pas possible. L’électrochoc est pratiqué à ce jour et trouve toute son indication dans les états dépressifs majeurs avec risque suicidaire.
D’autres cures étaient pratiquées, telle la cure de SAKEL ou choc hypoglycémique qui consiste à administrer de l’insuline jusqu'à l’apparition d’un coma corrigé par le glucagon ; la pyrétothérapie ou choc fébrile qui était basé sur l’inoculation d’une souche de plasmodium, provoquant une fièvre tierce corrigée par la quinine mais aussi l’alternance des fantasques douches froides et chaudes sans aucun argument scientifique.
Enfin, une intervention mutilante et invasive fut pratiquée : la lobotomie ou psychochirurgie, qui consistait en une section des fibres reliant le lobe frontal au reste du cerveau, en espérant la régénérescence d’autres fibres saines.
La psychiatrie moderne, la découverte de la CHLORPROMAZINE
En 1952, la Chlorpromazine révolutionna la psychiatrie en remplaçant la camisole de force par la camisole chimique. C’est le premier traitement chimique utilisé pour traiter les maladies mentales avec des résultats surprenants qui ont ouvert une nouvelle page dans le traitement des maladies mentales.
David Laing et Ronald Cooper ont mené une expérience à Kinsglay Hall en considérant la maladie mentale comme une forme d’expression du refus de la société telle qu’elle est érigée dans ses fondements : c’est le mouvement antipsychiatrique. Cependant, le meurtre d’un citoyen causé par un malade mental à une fête foraine en Italie a mis fin à l’aventure de l’antipsychiatrie et au psychiatre italien Basaglia, l’adepte de ce mouvement qui était derrière cette fête pour défendre ses croyance de « rendre la société à la folie et la folie à la société ».
Terminons par une histoire intrigante… ou belle ? Celle de Mary Barnes, une dame schizophrène qui est passée par tous les stades de la régression instinctivo-affectives atteignant le stade de gâtisme. Son barbouillage des murs par ses selles suscita les plaintes des pensionnaires et fit intervenir les antipsychiatres qui lui substituèrent les selles par de la peinture. Elle devint ultérieurement une artiste réputée dans les galeries de New York, et écrivit « Un voyage à travers la folie » où elle raconte son expérience et l’histoire de sa guérison par l’antipsychiatrie.
Conclusion
Parler de la psychiatrie, c’est relater ses errements, ses erreurs et les traces de son passé tumultueux. Les progrès actuels sont immenses offrant des perspectives d’avenir optimistes, qui envisagent une approche de plus en plus organiciste dans un cadre multidimensionnel, incluant l’environnement, la génétique et la neurobiologique.
Les traitements sont de plus en plus efficaces et les taux de guérison s’accroissent. De nouvelles études permettent de mieux comprendre la pathogénie de certaines maladies mentales ; les causes semblent être variées et multiples : du dysfonctionnement mitochondrial, incriminé dans le trouble bipolaire, à la suractivité de l’élagage synaptique chez les adolescents pour la schizophrénie.
Par ailleurs, nous déplorons le fait que la psychiatrie se soit dissociée de la psychologie et que la psychanalyse, avec tout ce qu’elle a apporté sur l’homme et sa socialisation, ne possède plus aucune place dans le cursus de l’étudiant en médecine. La thérapie de la parole, point fondamental de la pratique médicale a été malheureusement troquée par une thérapie exclusivement chimique.
Entre le psychique et l’organique, le palpable et l’imperceptible, l’histoire de la psychiatrie vient à peine de naître, et son avenir ne peut être qu’un autre long voyage à travers la folie.
Références
1- Philosophie de la Folie - Albert Daquin.
2- http://unf3s.cerimes.fr/media/paces/Grenoble_1112/bouge-rol_thierry/bougerol_thierry_p01/bougerol_thierry_p01.pdf
3- https://islamtraditionnel.blogspot.com/2008/04/lislam-et-la-psychiatrie.html?m=1
4- http://www.histoiredelafolie.fr/psychiatrie-neurologie/mala-dies-mentales-les-fondements-de-la-nosologie-lantiquite-par-michel-collee
5- http://medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/aaccue-med.htm
6- https://www.psychologytoday.com/us/blog/sacramento-street-psychiatry/201410/brief-history-psychiatry
7- http://psychiatrie.histoire.free.fr/





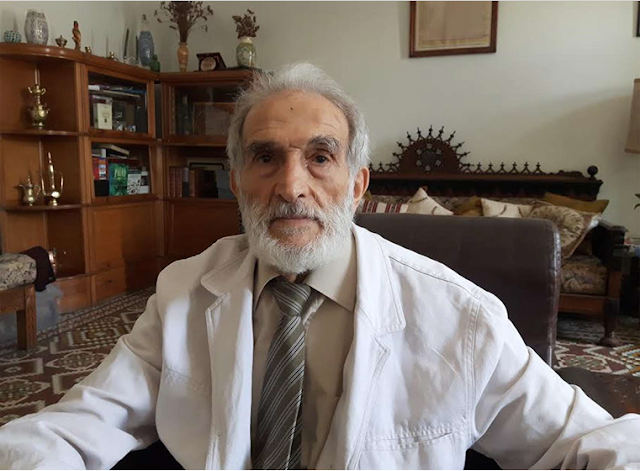
Commentaires
Enregistrer un commentaire