Voyage au Bout de la Littérature, « D’un Céline à l’autre »
Voyage au Bout de la Littérature, « D’un Céline à l’autre »
M’hamed BELBOUAB
 |
| http://www.weblettres.net/blogs/uploads/r/Roumegoux/22264.jpg |
- « Collabo ! »
- « Mais arrêtez…. Ce n’est même pas avéré qu’il ait collaboré… »
- « Comment avez-vous l’audace de défendre cette ordure d’antisémite ?! »
- « Je ne le défends pas, je rétablis des faits, comme le fait qu’il s’agit d’un des plus grands écrivains du 20ème siècle, que vous le veuillez ou non ! »
- « Il n’y a rien à tirer d’un homme pareil ! C’est une disgrâce d’avoir encore à débattre sur un énergumène pareille. »
Voilà à quoi pourrait ressembler un débat sur Céline. Un homme qui divise autant qu’il fascine, un écrivain qui est plus proche de faire l’unanimité. Ferdinand est un homme aux facettes multiples, pour la plupart détestables. Mais il demeure difficile à véritablement cerner, et le débat qu’il suscite reste très instructif sur l’évolution de l’écriture et de l’image des écrivains. Nous serons alors en droit de nous demander d’abord qui se cache derrière le pseudonyme de Céline ? Quel est le parcours de cet homme, pour le moins hors du commun ? Mais aussi, et dans un second temps, en quoi Céline pose-t-il la question de la distanciation entre l’œuvre et l’auteur ? Et est-elle vraiment possible ?
Au tout début il y avait Ferdinand…
Louis Ferdinand Destouches voit le jour en 1894. D’une petite famille bourgeoise, de la précarité en bouche, et des arrière-goûts de noblesse. La scène se déplace rapidement dans le quartier de l’Opéra à Paris, où il se révèle être un gamin discret, au parcours peu brillant, avec en compte, quelques séjours linguistique, en Allemagne et en Angleterre. Il sert de commis dans plusieurs bijouteries, avant de se résoudre à rejoindre les rangs de l’armée en 1912.
Manque de chance, la « grande guerre », comme on l’appelle déjà, éclate dès 1914. Il a alors 18 ans. Quelques mois plus tard, au détour d’une énième mission risquée, il est blessé au bras. Le mythe, et certainement l’auteur, feront croire plus tard qu’il fut capturé et blessé à la tête. Il devient par la suite agent de visas à Londres, avant d’être déclaré inapte (mutilo 75%) et d’être réformé.
S’ensuivent un séjour de près d’un an au Cameroun, d’où il revient malade, et une longue campagne contre la tuberculose sur les routes de Bretagne au côté de l’écrivain Henry de Graffigny pour le compte de la Fondation Rockefeller. Même fondation qui l’engagera, vers 1925 pour une mission de la Société des Nations qui le mènera aussi bien en Afrique qu’en Amérique. Car Ferdinand fait des études de médecine, et ce dès la fin de la guerre. Il s’installe à Rouen, passe son baccalauréat tout en vivant de petits boulots, puis rentre à la faculté où il suit le cursus allégé pour anciens militaires. Il épouse la fille du recteur, Edith Follet, dès 1919, et c’est d’elle qu’il aura son unique fille : Colette Destouches. Il obtient son diplôme en 1924, et sa thèse, dont l’écriture recèle déjà l’esquisse de son génie, porte sur les travaux d’hygiène obstétrique du docteur Semmelweis.
Il revient enfin à Paris, engagé par un dispensaire à Bezons. Il partage sa vie avec Elizabeth Craig, dès 1926, une danseuse américaine, rencontrée à Genève. Il travaille aussi comme visiteur médical, participe à la confection d’un médicament contre la maladie de Basedow et écrit divers articles pour la revue « La Presse Médicale ». Mais Ferdinand rêve de luxe et de grandeur, et une idée germe dans son esprit, il travaille depuis plusieurs années déjà à l’écriture d’un livre qui lui permettrait peut-être d’y accéder enfin.
Manque de chance, la « grande guerre », comme on l’appelle déjà, éclate dès 1914. Il a alors 18 ans. Quelques mois plus tard, au détour d’une énième mission risquée, il est blessé au bras. Le mythe, et certainement l’auteur, feront croire plus tard qu’il fut capturé et blessé à la tête. Il devient par la suite agent de visas à Londres, avant d’être déclaré inapte (mutilo 75%) et d’être réformé.
S’ensuivent un séjour de près d’un an au Cameroun, d’où il revient malade, et une longue campagne contre la tuberculose sur les routes de Bretagne au côté de l’écrivain Henry de Graffigny pour le compte de la Fondation Rockefeller. Même fondation qui l’engagera, vers 1925 pour une mission de la Société des Nations qui le mènera aussi bien en Afrique qu’en Amérique. Car Ferdinand fait des études de médecine, et ce dès la fin de la guerre. Il s’installe à Rouen, passe son baccalauréat tout en vivant de petits boulots, puis rentre à la faculté où il suit le cursus allégé pour anciens militaires. Il épouse la fille du recteur, Edith Follet, dès 1919, et c’est d’elle qu’il aura son unique fille : Colette Destouches. Il obtient son diplôme en 1924, et sa thèse, dont l’écriture recèle déjà l’esquisse de son génie, porte sur les travaux d’hygiène obstétrique du docteur Semmelweis.
Il revient enfin à Paris, engagé par un dispensaire à Bezons. Il partage sa vie avec Elizabeth Craig, dès 1926, une danseuse américaine, rencontrée à Genève. Il travaille aussi comme visiteur médical, participe à la confection d’un médicament contre la maladie de Basedow et écrit divers articles pour la revue « La Presse Médicale ». Mais Ferdinand rêve de luxe et de grandeur, et une idée germe dans son esprit, il travaille depuis plusieurs années déjà à l’écriture d’un livre qui lui permettrait peut-être d’y accéder enfin.
Un Voyage pour les gouverner tous !
Dans le but de garder son anonymat et préserver son image de médecin, L.F. Destouches choisit le pseudonyme « Céline », prénom de sa mère, et de sa grandmère avant elle. Il dédie le livre à Elizabeth, son « Impératrice », le plus grand amour de sa vie, qui le quittera pourtant, quelques mois après la parution du roman, pour aller admirer l’autre rive atlantique.
Un roman pas comme les autres, « Voyage au bout de la nuit ». On pourrait y voir une tentative, comme l’auteur, ainsi que ses détracteurs l’affirment, de se faire de l’argent, mais Céline n’écrit pas un bestseller, un roman grand public. Le livre donne l’impression d’avoir été écrit avec la volonté d’être numéro un, le meilleur, de rechercher une excellence dans sa spécificité.
Le succès est immédiat, la critique partagée, mais une seule certitude émane, ce sera le prix Goncourt de l’année 1932. Certitude démentie très vite par les résultats du prestigieux prix, qui est attribué à un autre auteur, vite passé à la trappe de l’histoire. Suite à quoi deux membres du jury démissionnent, faisant planer le doute, dès l’époque, sur la partialité et la neutralité du Goncourt. Céline devra donc se suffire du Renaudot. Tout d’abord, le roman détonne surtout par la forme, plus encore que le fond. Sa « petite musique » comme il aime la décrire, ce style elliptique, révolutionne la littérature du 20ème siècle : le langage parlé s’unit à l’écrit, de manière judicieuse et efficace, au plus près de l’émotion la plus immédiate. L’écriture est télégraphique, très argotique, et c’est ce qui choque, mais aussi empreinte d’une touche scientifique propre au parcours de l’auteur. Une mélodie qui oscille entre le familier et le recherché, l’humour et le désespoir.
Précisément, le désespoir, c’est la trame de fond de l’histoire de Bardamu. Au travers des yeux cyniques du personnage nous sont portées des images terribles du désarroi humain. On assiste aux ravages de la première guerre mondiale, aux affres des colonies africaines, à la déshumanisation dans les usines Ford (que Céline a visité au cours de sa mission pour la SDN), à la famine, à la pauvreté et à la précarité, mais aussi, et surtout, à l’anarchie intérieure de l’homme, ses angoisses, ses lubies. Un périple sur trois continents, où se succèdent humour, désolation, infamie humaine, et la misère sous toutes ses formes. Critique antimilitariste, anticolonialiste, anticapitaliste, certains iront à la considérer comme une « profession de foi humaniste ».
On improvise alors Ferdinand porte-parole des milieux défavorisés, et toute la gent de gauche l’approche. Louis Aragon lui-même essayera de le faire adhérer au parti communiste sans véritable succès, et sa compagne, Elsa Triolet, s’occupera de la traduction en russe de l’œuvre, et réussira à le faire inviter en URSS par la suite.
Meurtrissure et désillusion
Un roman pas comme les autres, « Voyage au bout de la nuit ». On pourrait y voir une tentative, comme l’auteur, ainsi que ses détracteurs l’affirment, de se faire de l’argent, mais Céline n’écrit pas un bestseller, un roman grand public. Le livre donne l’impression d’avoir été écrit avec la volonté d’être numéro un, le meilleur, de rechercher une excellence dans sa spécificité.
Le succès est immédiat, la critique partagée, mais une seule certitude émane, ce sera le prix Goncourt de l’année 1932. Certitude démentie très vite par les résultats du prestigieux prix, qui est attribué à un autre auteur, vite passé à la trappe de l’histoire. Suite à quoi deux membres du jury démissionnent, faisant planer le doute, dès l’époque, sur la partialité et la neutralité du Goncourt. Céline devra donc se suffire du Renaudot. Tout d’abord, le roman détonne surtout par la forme, plus encore que le fond. Sa « petite musique » comme il aime la décrire, ce style elliptique, révolutionne la littérature du 20ème siècle : le langage parlé s’unit à l’écrit, de manière judicieuse et efficace, au plus près de l’émotion la plus immédiate. L’écriture est télégraphique, très argotique, et c’est ce qui choque, mais aussi empreinte d’une touche scientifique propre au parcours de l’auteur. Une mélodie qui oscille entre le familier et le recherché, l’humour et le désespoir.
Précisément, le désespoir, c’est la trame de fond de l’histoire de Bardamu. Au travers des yeux cyniques du personnage nous sont portées des images terribles du désarroi humain. On assiste aux ravages de la première guerre mondiale, aux affres des colonies africaines, à la déshumanisation dans les usines Ford (que Céline a visité au cours de sa mission pour la SDN), à la famine, à la pauvreté et à la précarité, mais aussi, et surtout, à l’anarchie intérieure de l’homme, ses angoisses, ses lubies. Un périple sur trois continents, où se succèdent humour, désolation, infamie humaine, et la misère sous toutes ses formes. Critique antimilitariste, anticolonialiste, anticapitaliste, certains iront à la considérer comme une « profession de foi humaniste ».
On improvise alors Ferdinand porte-parole des milieux défavorisés, et toute la gent de gauche l’approche. Louis Aragon lui-même essayera de le faire adhérer au parti communiste sans véritable succès, et sa compagne, Elsa Triolet, s’occupera de la traduction en russe de l’œuvre, et réussira à le faire inviter en URSS par la suite.
Meurtrissure et désillusion
Céline ne tardera pas à refrapper : « Mort à crédit » est publié en 1936. Il y aura mis sa « peau sur la table » comme on l’entendra dire, plus tard, dans certaines interviews. Il l’a conçu comme l’aboutissement de son style, l’apothéose de son art. Cependant, si le livre se vend bien, il est lynché par la critique, aussi bien de gauche que de droite.
Sorti dans un contexte de grève du front populaire, le temps n’est plus à cela, ce n’est plus le temps pour un récit autobiographique, tinté d’argot, aux phrases disloquées, et au lyrisme exacerbé. La France a besoin de philosophes, d’hommes politiques, pas d’écrivains dira-t-on, du moins… pas de Céline.
C’est la disgrâce, le désaveu, ceux qui l’adulaient iront même à dire que Céline « piétine dans la merde ». La blessure est béante, et le divorce consommé.
Il se rend en URSS par la suite, vers la fin de l’année et en revient déçu, comme Gide avant lui. Et, comme Gide, il décide de publier un pamphlet à charge contre le communisme, « Mea Culpa ». Cris cinglant contre tout optimisme, et toute illusion que l’on sert au peuple : Le communisme est un mensonge, un de plus, et il ne vaut pas mieux que les autres courants de l’époque. Son amertume commence déjà à se faire sentir, ses talents de vociférateur aussi, et ils connaitront leur apogée durant la deuxième guerre mondiale.
L’autre Céline, cet antisémite !
Sorti dans un contexte de grève du front populaire, le temps n’est plus à cela, ce n’est plus le temps pour un récit autobiographique, tinté d’argot, aux phrases disloquées, et au lyrisme exacerbé. La France a besoin de philosophes, d’hommes politiques, pas d’écrivains dira-t-on, du moins… pas de Céline.
C’est la disgrâce, le désaveu, ceux qui l’adulaient iront même à dire que Céline « piétine dans la merde ». La blessure est béante, et le divorce consommé.
Il se rend en URSS par la suite, vers la fin de l’année et en revient déçu, comme Gide avant lui. Et, comme Gide, il décide de publier un pamphlet à charge contre le communisme, « Mea Culpa ». Cris cinglant contre tout optimisme, et toute illusion que l’on sert au peuple : Le communisme est un mensonge, un de plus, et il ne vaut pas mieux que les autres courants de l’époque. Son amertume commence déjà à se faire sentir, ses talents de vociférateur aussi, et ils connaitront leur apogée durant la deuxième guerre mondiale.
L’autre Céline, cet antisémite !
Céline va vite se prendre au jeu des pamphlets. Il en publie trois durant la guerre de 39/45 : « Bagatelles pour un massacre », « L’École des cadavres » et « Les Beaux Draps ». Des centaines de pages de colère et de haine, avec un ennemi tout désigné : Les juifs. Une logorrhée, insoutenable, où Céline n’épargne personne, ni le régime de Pétain, ni les résistants.
Elevé dans une famille antisémite, ayant perdu sa dulcinée au bras d’un riche Juif américain, et se sentant persécuté par les critiques et éditeurs, en majorité juifs à l’époque, ce sera pour lui l’ennemi parfait, la raison de tous ses maux et de toutes ses défaites. Un antisémitisme qui se mêle dans son cas à un racisme aveugle, très en phase avec son époque. Pour lui, il faut redresser la race française, lui imposer une cure d’abstinence, une mise à l’eau, une rééducation corporelle et physique, et, Vichy étant pire que tout, il voit la solution dans l’alliance avec l’Allemagne nazie, au nom d’une communauté de race conçue sur les lignes ethno racistes des séparatistes alsaciens, bretons et flamands, rejetant de même les populations du sud français trop métissées à son goût.
Maintenant, il existe peu de preuves qu’il ait vraiment collaboré avec le régime allemand, même si un livre paru en 2015 s’appuie sur de nouveaux documents du régime d’occupation pour l’affirmer. Néanmoins, il ne se privait pas de traiter tous ses détracteurs de juifs dans de longues tribunes parues dans des revues d’extrême droite, ni même de demander du papier à l’autorité allemande pour la réédition de ses livres en pleine occupation. Ce qui lui sera accordé au vu de ses relations de proximité avec les notables du régime.
Céline enrage, ne cède pas, il ne se refuse rien, dépasse toutes les limites, c’est désormais un paria. Il est d’ailleurs contraint de s’enfuir avec sa femme dès le débarquement de 44, il part en Allemagne avec sa seconde épouse, d’abord vers Baden-Baden, puis vers Sigmaringen où ils rejoindront les cadres du régime de Vichy, et où Céline servira de médecin. Il s’exile par la suite au Danemark, passe plus d’un an en prison, sans être extradé, puis, par une habile manœuvre juridique, arrive à retourner en France en 1951.
Il s’installe à Meudon, dans une demeure, devenu Mecque des nombreux fanatiques de l’auteur. Il y exerce la médecine, y élève des animaux à foison et se remet à écrire, inlassablement. Naîtront alors la trilogie allemande, trois romans qui retracent l’exil de Céline et son voyage à travers l’Allemagne jusqu’au Danemark, trois romans au style encore plus tranché : « D’un château l’autre », « Nord », et « Rigodon ». Une littérature de l’extrême qui finira de placer Céline au panthéon des écrivains de son siècle.
Mais Céline ne s’excusera jamais, c’est plutôt l’inverse. Il ne cessera de défendre sa situation d’auteur maudit, déchu, spolié, malaimé. Il s’obstinera à ne pas republier ses pamphlets, ni à en reparler clairement, s’invoquant un droit à l’oubli, qu’il n’aura jamais vraiment. Le 1er juillet 1961, il décède chez lui, vraisemblablement des suites d’une athérosclérose.
Elevé dans une famille antisémite, ayant perdu sa dulcinée au bras d’un riche Juif américain, et se sentant persécuté par les critiques et éditeurs, en majorité juifs à l’époque, ce sera pour lui l’ennemi parfait, la raison de tous ses maux et de toutes ses défaites. Un antisémitisme qui se mêle dans son cas à un racisme aveugle, très en phase avec son époque. Pour lui, il faut redresser la race française, lui imposer une cure d’abstinence, une mise à l’eau, une rééducation corporelle et physique, et, Vichy étant pire que tout, il voit la solution dans l’alliance avec l’Allemagne nazie, au nom d’une communauté de race conçue sur les lignes ethno racistes des séparatistes alsaciens, bretons et flamands, rejetant de même les populations du sud français trop métissées à son goût.
Maintenant, il existe peu de preuves qu’il ait vraiment collaboré avec le régime allemand, même si un livre paru en 2015 s’appuie sur de nouveaux documents du régime d’occupation pour l’affirmer. Néanmoins, il ne se privait pas de traiter tous ses détracteurs de juifs dans de longues tribunes parues dans des revues d’extrême droite, ni même de demander du papier à l’autorité allemande pour la réédition de ses livres en pleine occupation. Ce qui lui sera accordé au vu de ses relations de proximité avec les notables du régime.
Céline enrage, ne cède pas, il ne se refuse rien, dépasse toutes les limites, c’est désormais un paria. Il est d’ailleurs contraint de s’enfuir avec sa femme dès le débarquement de 44, il part en Allemagne avec sa seconde épouse, d’abord vers Baden-Baden, puis vers Sigmaringen où ils rejoindront les cadres du régime de Vichy, et où Céline servira de médecin. Il s’exile par la suite au Danemark, passe plus d’un an en prison, sans être extradé, puis, par une habile manœuvre juridique, arrive à retourner en France en 1951.
Il s’installe à Meudon, dans une demeure, devenu Mecque des nombreux fanatiques de l’auteur. Il y exerce la médecine, y élève des animaux à foison et se remet à écrire, inlassablement. Naîtront alors la trilogie allemande, trois romans qui retracent l’exil de Céline et son voyage à travers l’Allemagne jusqu’au Danemark, trois romans au style encore plus tranché : « D’un château l’autre », « Nord », et « Rigodon ». Une littérature de l’extrême qui finira de placer Céline au panthéon des écrivains de son siècle.
Mais Céline ne s’excusera jamais, c’est plutôt l’inverse. Il ne cessera de défendre sa situation d’auteur maudit, déchu, spolié, malaimé. Il s’obstinera à ne pas republier ses pamphlets, ni à en reparler clairement, s’invoquant un droit à l’oubli, qu’il n’aura jamais vraiment. Le 1er juillet 1961, il décède chez lui, vraisemblablement des suites d’une athérosclérose.
Mémoire sélective
Plus de soixante ans après, Céline questionne toujours : Doit-on lire Céline ? Si oui, peut-on dissocier l’auteur de son œuvre ?
Au tout début, il est bon de se demander ce que l’on attend en fin de compte d’un auteur. Le romancier serait cet historien des cœurs, ce photographe, qui peut passer au filtre des mœurs, du ressenti propre toute une société, celui qui peut en capturer l’essence, l’air d’un temps, quel qu’il soit. Une sorte d’alchimiste des mots, qu’il arrive à métamorphoser, mais aussi un penseur, un vecteur d’idées qu’il présente, qu’il défend, le porte-parole d’une époque.
C’est donc un personnage assez trouble, et il peut revêtir plusieurs casquettes, en changer au cours de sa carrière, mais une chose est sûre : un romancier n’est pas un enfant de cœur, ou très peu. S’il fallait être un saint pour bien écrire, « ça se saurait », il s’agit même plutôt de l’inverse : Il faut souvent avoir pataugé dans la réalité poisseuse pour avoir des choses à raconter.
Céline se définit lui-même comme étant un « styliste » de la langue, et ses œuvres sont reconnues comme étant de purs chefs-d’œuvre en la matière. C’est un vociférateur né, quelqu’un qui existe pour déranger, pour enrager : c’est la dissonance. Il ne s’excusera jamais d’avoir écrit ce qu’il a écrit, il ne fait pas dans le repentir, ne cherche pas le pardon. Il s’est vengé en vomissant sa haine, celle de la bête blessée qu’il était, et qu’il a continuée d’être.
On pourrait trouver mille raisons, en plus de celles citées en sus, pour expliquer l’antisémitisme si tenace de Céline, il n’en demeure pas moins inexcusable et sordide. Il épouse l’esprit de son époque, et sa pensée se calque sur l’antisémitisme de l’Etat français d’avant-guerre, comme en attestent les manifestations d’extrême droite de 1934 et les attaques contre Léon Blum à la même époque. Véritables appels au massacre, écrits de référence pour les milieux d’extrême droite pendant la guerre, les pamphlets de Céline appartiennent aux cahiers noirs et honteux de la littérature. Néanmoins, si on est amené à lire l’œuvre, on peut aussi se demander si ce n’est pas un exercice trop périlleux d’en extirper l’auteur. En effet, la relation entre l’auteur et l’œuvre est souvent marquée, et pour comprendre pleinement l’une il faudra comprendre pleinement l’autre. Le parcours de l’auteur est souvent crucial pour essayer de comprendre les sujets qu’il aborde, et sa manière de le faire. On ne peut saisir l’entière beauté de l’œuvre de Proust, sans savoir qu’il a passé le plus clair de sa vie malade dans son lit. On ne peut saisir la profondeur du théâtre de Brecht, sans connaître ses engagements politiques. On ne peut saisir l’ampleur de la folie dans les œuvres de Maupassant sans savoir que l’auteur souffrait de troubles psychiatriques dus à sa syphilis, qu’il décrit notamment dans le Horla. L’époque, le contexte, autant même que le parcours de l’auteur sont des clefs d’analyse de leurs œuvres, qui permettent de révéler toutes leurs facettes.
Néanmoins, la coupure, quand elle est possible, est souvent nécessaire, car les mœurs, les sociétés changent, et les valeurs morales aussi. On découvrit bien tard que HP Lovecraft fut raciste, comme le prouvent certaines de ses lettres clairement antisémites. Mais aussi que Lewis Carroll, l’auteur d’Alice Au Pays Des Merveilles gardait des centaines de photos de son modèle de la jeune Alice nue, fait presque normal pour l’aristocratie de l’époque, mais qui aujourd’hui le ferait condamner pour pédophilie. On peut aussi citer Baudelaire et Hugo, terribles misogynes… et puis Rimbaud qui finira marchand d’armes, et la liste s’allonge. Aussi inexcusables et impardonnables que furent tous ces auteurs, leurs œuvres comptent pourtant parmi les plus appréciées et les plus appréciables, et c’est à ce moment que la distanciation s’opère.
Il s’agira alors de tirer le meilleur de l’œuvre en tant que telle, comme l’on tirerait les enseignements philosophiques si utiles des œuvres de Voltaire, Montesquieu ou Rousseau, tous trois racistes et esclavagistes notoires, ou encore de Heidegger, un proche du troisième Reich. Il ne s’agira pas d’excuser, ou même de relativiser, car le but n’est pas là, il est tout autre. Il est plutôt de réussir, en funambule, à extirper la valeur artistique de l’œuvre en tant que telle.
Dans le cas Céline, la césure est à faire, et elle est plus ou moins facile car l’œuvre romanesque reste, le plus souvent, très éloignée de sa pensée politique, qui se résume à ses pamphlets, ses tribunes, et à ses larges correspondances.
Ainsi, si certains rêveraient de voir le tout Céline brûlé sur un bucher, d’autres, à les entendre, se crèveraient les yeux au lieu d’en lire, mais y perdraient, par-dessus la vue, de passer à côté de l’une des écritures les plus intéressantes et innovantes du 20ème siècle. On serait effectivement tenté, en faisant connaissance plus ample avec le personnage de le traiter de tous les noms, mais l’œuvre reste à lire, et l’avis personnel à se faire.
Au tout début, il est bon de se demander ce que l’on attend en fin de compte d’un auteur. Le romancier serait cet historien des cœurs, ce photographe, qui peut passer au filtre des mœurs, du ressenti propre toute une société, celui qui peut en capturer l’essence, l’air d’un temps, quel qu’il soit. Une sorte d’alchimiste des mots, qu’il arrive à métamorphoser, mais aussi un penseur, un vecteur d’idées qu’il présente, qu’il défend, le porte-parole d’une époque.
C’est donc un personnage assez trouble, et il peut revêtir plusieurs casquettes, en changer au cours de sa carrière, mais une chose est sûre : un romancier n’est pas un enfant de cœur, ou très peu. S’il fallait être un saint pour bien écrire, « ça se saurait », il s’agit même plutôt de l’inverse : Il faut souvent avoir pataugé dans la réalité poisseuse pour avoir des choses à raconter.
Céline se définit lui-même comme étant un « styliste » de la langue, et ses œuvres sont reconnues comme étant de purs chefs-d’œuvre en la matière. C’est un vociférateur né, quelqu’un qui existe pour déranger, pour enrager : c’est la dissonance. Il ne s’excusera jamais d’avoir écrit ce qu’il a écrit, il ne fait pas dans le repentir, ne cherche pas le pardon. Il s’est vengé en vomissant sa haine, celle de la bête blessée qu’il était, et qu’il a continuée d’être.
On pourrait trouver mille raisons, en plus de celles citées en sus, pour expliquer l’antisémitisme si tenace de Céline, il n’en demeure pas moins inexcusable et sordide. Il épouse l’esprit de son époque, et sa pensée se calque sur l’antisémitisme de l’Etat français d’avant-guerre, comme en attestent les manifestations d’extrême droite de 1934 et les attaques contre Léon Blum à la même époque. Véritables appels au massacre, écrits de référence pour les milieux d’extrême droite pendant la guerre, les pamphlets de Céline appartiennent aux cahiers noirs et honteux de la littérature. Néanmoins, si on est amené à lire l’œuvre, on peut aussi se demander si ce n’est pas un exercice trop périlleux d’en extirper l’auteur. En effet, la relation entre l’auteur et l’œuvre est souvent marquée, et pour comprendre pleinement l’une il faudra comprendre pleinement l’autre. Le parcours de l’auteur est souvent crucial pour essayer de comprendre les sujets qu’il aborde, et sa manière de le faire. On ne peut saisir l’entière beauté de l’œuvre de Proust, sans savoir qu’il a passé le plus clair de sa vie malade dans son lit. On ne peut saisir la profondeur du théâtre de Brecht, sans connaître ses engagements politiques. On ne peut saisir l’ampleur de la folie dans les œuvres de Maupassant sans savoir que l’auteur souffrait de troubles psychiatriques dus à sa syphilis, qu’il décrit notamment dans le Horla. L’époque, le contexte, autant même que le parcours de l’auteur sont des clefs d’analyse de leurs œuvres, qui permettent de révéler toutes leurs facettes.
Néanmoins, la coupure, quand elle est possible, est souvent nécessaire, car les mœurs, les sociétés changent, et les valeurs morales aussi. On découvrit bien tard que HP Lovecraft fut raciste, comme le prouvent certaines de ses lettres clairement antisémites. Mais aussi que Lewis Carroll, l’auteur d’Alice Au Pays Des Merveilles gardait des centaines de photos de son modèle de la jeune Alice nue, fait presque normal pour l’aristocratie de l’époque, mais qui aujourd’hui le ferait condamner pour pédophilie. On peut aussi citer Baudelaire et Hugo, terribles misogynes… et puis Rimbaud qui finira marchand d’armes, et la liste s’allonge. Aussi inexcusables et impardonnables que furent tous ces auteurs, leurs œuvres comptent pourtant parmi les plus appréciées et les plus appréciables, et c’est à ce moment que la distanciation s’opère.
Il s’agira alors de tirer le meilleur de l’œuvre en tant que telle, comme l’on tirerait les enseignements philosophiques si utiles des œuvres de Voltaire, Montesquieu ou Rousseau, tous trois racistes et esclavagistes notoires, ou encore de Heidegger, un proche du troisième Reich. Il ne s’agira pas d’excuser, ou même de relativiser, car le but n’est pas là, il est tout autre. Il est plutôt de réussir, en funambule, à extirper la valeur artistique de l’œuvre en tant que telle.
Dans le cas Céline, la césure est à faire, et elle est plus ou moins facile car l’œuvre romanesque reste, le plus souvent, très éloignée de sa pensée politique, qui se résume à ses pamphlets, ses tribunes, et à ses larges correspondances.
Ainsi, si certains rêveraient de voir le tout Céline brûlé sur un bucher, d’autres, à les entendre, se crèveraient les yeux au lieu d’en lire, mais y perdraient, par-dessus la vue, de passer à côté de l’une des écritures les plus intéressantes et innovantes du 20ème siècle. On serait effectivement tenté, en faisant connaissance plus ample avec le personnage de le traiter de tous les noms, mais l’œuvre reste à lire, et l’avis personnel à se faire.
80 ans plus tard, Ferdinand fait toujours débat, il fascine autant qu’il répugne. Certains s’acharnent à prouver la sordidité du personnage, là où d’autres adulent aveuglement son génie. Personnage atypique, dérangé, dérangeant, détestable, sa lecture vous laisse rarement insensible. Entre horreur et beauté littéraire, que valent donc les idéaux portés par le voyage, et quels enseignements pouvons-nous tirer de l’œuvre Célinienne ? Une chose est sûre, comme tout auteur à scandale, la récupération nauséabonde est à guetter, et de toutes parts. Le projet de republication des pamphlets de Céline par Gallimard s’y apparente. Le « délire » Célinien, comme l’appelait Gide, déjà accessible sur internet, ou sous le manteau, mérite effectivement qu’on s’y attarde (et c’est déjà largement le cas), avec tous les risques de dérives qui peuvent y être associés. Un tel projet de réédition a pour unique but, comme tout projet d’édition, de générer du profit sur fond de spectacle médiatique, ce qui, dans ce cas loin d’être isolé, soulève un questionnement moral profond au vu de la nature des œuvres en question.

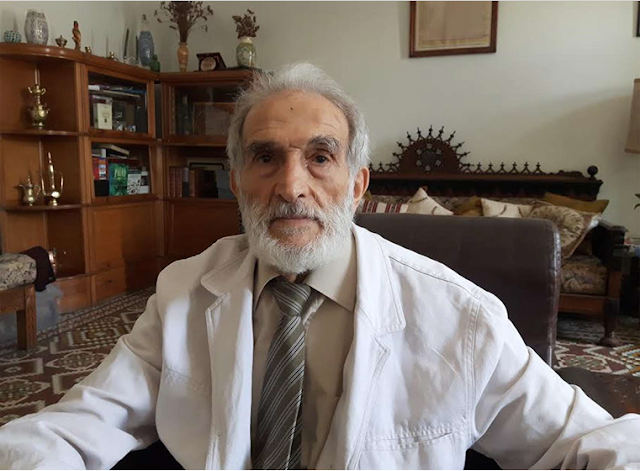
Commentaires
Enregistrer un commentaire