Ambulo Ergo Sum
Ambulo Ergo Sum*
Mettre un pied devant l'autre, pour une destination, ou pour un inconnu, dans un but ou sans, c'est ce que l'on appelle marcher. Les voyages, les pèlerinages, les randonnées, les promenades, les flâneries, tant de formes d'un seul et même mouvement perpétuel, celui du corps dans l'espace, celui de l'esprit dans le paysage. On marche pour se « vider la tête », « s'aérer l'esprit », mais aussi surtout et le plus souvent uniquement dans le but d’« entretenir sa forme ». Mais est-ce tout ce que la marche a à nous offrir ? n’y a-t-il pas d’autres dimensions à la marche ? Cheminement qui nous laisse entrevoir que du marcheur au penseur il n’y a peut-être qu’un pas.
La marche, un simple exercice physique ?
La marche, un simple exercice physique ?
Depuis l'aube
des temps, l'Homme marche pour survivre. En effet, L'Homo Sapiens a d'abord été
Erectus, et l'errance semble avoir participé à l'essor de ses découvertes et de
sa pensée. Considérée par beaucoup comme un simple moyen de locomotion, ou
comme un moyen d’entretenir son corps, on retrouve à travers l’histoire
plusieurs penseurs qui lui trouvent bien d’autres avantages, parmi eux
Aristote.
Surnommé le
peripatetikós (en grec « qui aime se promener »), la légende voudrait qu'il ait
enseigné à ses disciples en marchant. Ils arrivaient au gymnase dès l'aube,
puis l'arpentaient longuement, s'exerçant avant l'activité physique, à la
philosophie. Bien des penseurs de son époque semblaient eux aussi trouver des
vertus à la marche, à l’instar des Sophistes, Protagoras le premier, qui
vendent leur savoir en marchant. Mais aussi des cyniques, comme Diogène, qui,
armé de son célèbre bâton déambule dans Athènes. Ou encore Socrate et ses
compagnons. Mais cet engouement ne s’arrête pas à l’antiquité.
Un outil de réflexion
Un outil de réflexion
La marche comme
tant d’autres activités répétitives, crée un interstice propice à la pensée, et
catalyse la réflexion. Cependant, la déambulation dans la nature, ou dans la
ville, l’expérience de l’espace, et l’effort physique qui l’accompagnent en
font pour beaucoup un outil sans pareil, une manière d’astreindre l’intellect
au charnel.
Parmi ceux-là,
Kant. Si elles sont d’abord dans un but hygiénique, les promenades quotidiennes
de Kant dans Königsberg (sa ville natale qu'il n'a jamais quittée) s’étaient
vite avérées être vitales pour le philosophe. Il devint ainsi un véritable
métronome de la ville. La tradition rapporte que Kant ne modifia son emploi du
temps immuable et la trajectoire de sa promenade quotidienne que deux fois
durant toute sa vie. Ceci n’empêche pas Nietzche de décrier sa manière de
marcher qui, selon lui se rapproche plus de l’entretien physique que psychique.
En effet, la
figure de proue des penseurs adeptes de la marche est Nietzsche. Il n’a cessé
de marcher, jusqu’à 6 heures par jours, seul ou en groupe dans toute l’Europe,
avant d’être frappé par la maladie et la folie et finir sa vie sur une chaise
roulante. Véritable penseur du plein air, pour lui la marche n’est pas une
pratique accessoire, comme elle pouvait l’être chez Kant, mais une condition
sine qua none de la pensée. Dans ses enseignements figuraient : « ne prêter foi
à aucune pensée qui n'ait été composée au grand air, dans le libre mouvement du
corps - à aucune idée où les muscles n'aient été eux aussi de la fête. »
D’ailleurs, il ne manquera pas de décrier aussi Flaubert qui aura le malheur de
dire qu’il écrivait mieux en étant assis. Pensée que l’on retrouve également
chez Kierkegaard qui affirma : « mes meilleures pensées sont venues en
marchant, et je ne connais aucune pensée si lourde qu'on ne puisse s'en
éloigner à grands pas ».
Une école de vie
Pourtant, il ne suffit pas de mettre un pied devant l’autre pour s’improviser penseur. Les émotions et le ressenti, les enseignements que procurent la marche ouvrent de nouveaux horizons, et fournissent un terreau riche que chacun peut utiliser à fin de faire avancer ses idées.
Chacun, oui,
car la marche s’adresse et est à la portée de tous. C’est une école de la
patience, de la persévérance et de l’effort. Le piéton, est piètre par
définition, il est simple, frugal, et en quête de l’essence des choses. En
effet, on laisse derrière soit lors d’une ascension ou d’une randonnée, les
masques sociaux, les tracas du quotidien, pour renouer avec la jouissance
élémentaire, pour renouer avec ce qu’il y a de plus authentique de plus ancien
et de plus essentiel chez l’homme.
Ce sont de
telles valeurs apprises dans la marche, que Rousseau essaye de transmettre. En
effet, cet amoureux des promenades, pour qui « qu'importe la destination, ce
qui importe c'est le chemin », encourage à la marche dans son manuel
d’enseignement Émile ou De l'éducation. Il fut accablé lorsque son grand âge et
la maladie l’obligèrent à troquer ses jambes pour des roues.
Un retour à la nature
La marche est aussi un moyen de découverte par ses propres sens de la nature : L’esthétique dans la simplicité, les joies des silences et des symphonies éoliennes. Marcher, c’est découvrir, « vivre » à la manière dont l’entend Thoreau, un préalable à toute activité intellectuelle digne de ce nom.
Un retour à la nature
La marche est aussi un moyen de découverte par ses propres sens de la nature : L’esthétique dans la simplicité, les joies des silences et des symphonies éoliennes. Marcher, c’est découvrir, « vivre » à la manière dont l’entend Thoreau, un préalable à toute activité intellectuelle digne de ce nom.
Ce dernier,
poète naturaliste américain, affirmait du fond de sa cabane perdue dans les
forêts de Walden, que « l’être humain commence par les pieds ». Pour lui,
accéder à un endroit isolé au bout de plusieurs heures d’efforts, c’est se
l’approprier, le graver dans son corps et dans sa mémoire. C’est la
gratification de l’exploit, et la satisfaction que le marcheur vient chercher.
Ce dernier affirme qu’ « il est vain de s'asseoir pour écrire quand on ne s'est
jamais levé pour vivre ».
Ce
ressourcement dans la nature, et ces aventures au plein air, sont chers aux
auteurs romantiques, qui y trouvent leur inspiration. C’est aussi le cas de
l’écrivain anglais Stevenson, qui déclarait qu’il n’écrivait qu’au retour de
longues escapades, (Certains tracés de randonnée en France gardent toujours son
nom) qui lui fournissaient la matière nécessaire à ses histoires.
Une quête des sens
Une quête des sens
Sous forme de
pèlerinage ou de processions mystiques, on retrouve souvent un lien étroit
entre la marche et le spirituel. En effet, de pareilles démarches qui
nécessitent de tout laisser derrière soi, et s’inscrire dans un long et
tortueux périple sont propices aux réflexions solitaires, aux révélations
mystiques, et aux rétrospections. Ce qui nous renvoie aux mots de
l’anthropologue David Le Breton : « c’est dans la trame du chemin que se cache
le fil de l’existence ».
Que ce soit
vers la Mecque, ou sur les sentiers de Compostelle, nombre de religions,
exhortent à voyager dans le dépouillement total, et la dévotion absolue, en
quête d’une divinité. La piété du marcheur est alors mise à l’épreuve, ainsi
que son corps et son esprit. Il rejoint, un long cortège d’âmes et de pieds qui
ont foulé ces mêmes chemins millénaires dans un même but, celui d’accéder au
créateur, mais aussi peut-être d’accéder à eux-mêmes, et au sens de leur propre
existence. Le chemin devient alors une longue prière, les rencontres un signe
divin, les peines une expiation, et la mort une salvation.
Véritables
quêtes de sens, les pèlerinages sont présents sous d’autres formes dans
beaucoup de cultures. On peut citer, les Huichols, tribu du Mexique, qui
parcourent 800 kilomètres, dans le dénuement le plus total à travers montagnes
et déserts, respectant un tracé millénaire. Ce périple, sert à forger les
hommes de la tribu, à honorer leurs ancêtres et leurs divinités, et à
s’approvisionner en champignons hallucinogènes. Consommés sur le chemin du
retour, ces champignons font de la procession une marche aux allures de transe
mystique par laquelle on est sensé accéder à la sagesse des anciens.
Une forme de contestation
Une forme de contestation
La marche peut être une manière d’exprimer sa pensée, ou être un acte engagé, c’est d’ailleurs la forme que prennent couramment les manifestations. Elle devient alors un mouvement collectif, elle défraie avec l’inactivité, et revendique l’avancée et le changement. Symbole de vie, d’action et d’engagement, la marche s’est imposée dans l’histoire des contestations et des revendications.
On peut prendre
exemple, de la poétesse vietnamienne Ho Xuan Huong, au XVIIIe siècle, qui fit
de la marche un moyen de s’émanciper et de s’affirmer dans sa société. Mais
aussi, la marche du Sel de Ghandi, en 1930, un long périple où, sur plusieurs
centaines de kilomètres, l’homme âgé de 60 ans, accompagné par un groupe
croissant de militants, défia le colonisateur anglais, en allant ramener du sel
des villes côtières de l’inde et contourner l’embargo imposé sur la denrée. Ou
encore, des marches contre le racisme de Luther King, achevées par son célèbre
discours.
Une activité urbaine
Une activité urbaine
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la marche n’est pas strictement réservée aux amoureux de la nature. Il s’agit aussi d’une activité qui s’exerce aussi en ville. Les paysages urbains fourmillent de détails, et le mouvement constant est une manne pour tous ceux qui veulent y prêter attention. Comme le montre le personnage du « flâneur » de Rimbaud, le poète marcheur, l’homme aux sandales de vent, ou encore le personnage de l’« Homme de la foule » de E.A Poe.
Flâner qualifie
l’action du penseur et de l’observateur passionnés, qui traversent la ville,
sans chemin préétabli et sans destination précise, dans le but d’en absorber
l’essence, et d’en retranscrire l’âme. Vision qui se développera encore plus
tard dans la marche des Surréalistes, tel qu’André Breton, et chez les petits
groupes de réflexion des situationnistes. Tohubohu, brouhaha, fresques
humaines, à chaque passage piéton, des milliers d’histoires derrières chaque
mur, et sur chaque pavé, autant de trésors pour les flâneurs, ces marcheurs
urbains.
Un pied de nez à la modernité
Nous vivons à l’air de l’anachronisme corporel. Tout est mis en œuvre pour minimiser les déplacements, vers l’homme statique, amorphe, enraciné. Et lorsqu’ils sont nécessaires, alors tout est fait pour en réduire le temps, pour effacer le voyage. Le déplacement est motorisé, l’homme perd la notion de l’espace, de la distance, il est détaché de son environnement, et s’entiche d’un autre, virtuel. L’essence se substitue au sens, au prix d’une course effrénée à la poursuite d’un temps dont on ne saurait profiter. C’est cette dématérialisation du corps, que l’on entretient d’une manière mécanique dans une salle, pour le replacer dans un fauteuil, ou derrière un volant, qui entraine la remontée spectaculaire de la marche dans les activités de loisir.
Nous vivons à l’air de l’anachronisme corporel. Tout est mis en œuvre pour minimiser les déplacements, vers l’homme statique, amorphe, enraciné. Et lorsqu’ils sont nécessaires, alors tout est fait pour en réduire le temps, pour effacer le voyage. Le déplacement est motorisé, l’homme perd la notion de l’espace, de la distance, il est détaché de son environnement, et s’entiche d’un autre, virtuel. L’essence se substitue au sens, au prix d’une course effrénée à la poursuite d’un temps dont on ne saurait profiter. C’est cette dématérialisation du corps, que l’on entretient d’une manière mécanique dans une salle, pour le replacer dans un fauteuil, ou derrière un volant, qui entraine la remontée spectaculaire de la marche dans les activités de loisir.
D’abord,
marcher c’est faire l’expérience du temps, avancer avec lenteur et respect sans
oublier de penser. Chaque grain que foule le marcheur, il l’observe se
décompter du sablier du temps. Les minutes s’étirent, à l’heure où tout va trop
vite. Ensuite, Le marcheur fait l’expérience de la quiétude, il est déconnecté,
il sort de la machinerie imposée par son quotidien, il prend le choix hérétique
de ne rien faire si ce n’est marcher, il va à contre sens. Par ailleurs, Il
fait aussi l’expérience de la distance, et celle de son environnement, d’une
manière qui serait impossible à reproduire en voiture.
On chemine
alors, vers une marche en contre mouvement, une marche comme refuge à la
modernité dévorante, une marche qui compte de plus en plus d’adeptes. Une
marche pour ne plus être pris par le temps, mais pour le prendre, une marche
pour reprendre l’ascendant sur sa vie.
Que ce soit une randonnée en plein air, ou une flânerie urbaine, en
quête de soi, de Dieu, ou en signe de protestation, chaque marche est une
aventure de laquelle on sort grandi, un espace de réflexion éloigné des livres
et des bibliothèques, éloigné des conventions, une manière d’imposer le relief
à la platitude de la vie. Ainsi, la représentation la plus fidèle du Penseur,
ne serait peut-être pas la sculpture éponyme de Rodin, mais plutôt « L’Homme
qui marche » de Giacometti. Si les bienfaits de la marche en tant qu’exercice
physique ne sont plus à prouver, il existe néanmoins une autre dimension,
connue uniquement par ses fervents adeptes, celle de l’exercice spirituel.
* Je marche donc je suis.
* Je marche donc je suis.





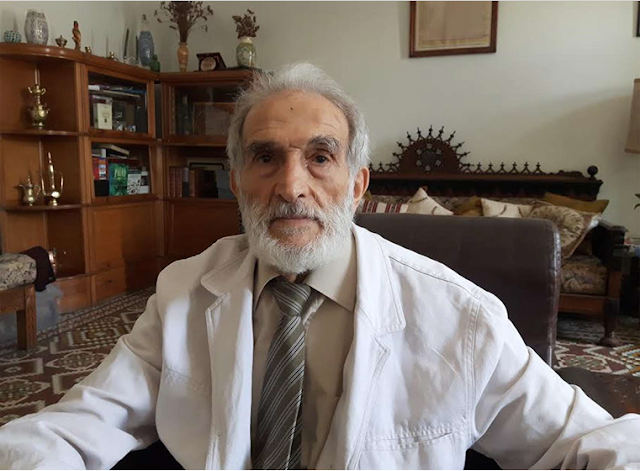
Commentaires
Enregistrer un commentaire